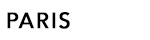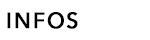|
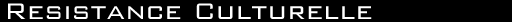

Bertrand Badie: «L’Occident doit compter avec un monde qui n’est plus exclusivement le sien»
Par Marc Semo et Catherine Calvet
Selon
le politologue Bertrand Badie, le Nord ne maîtrise plus
l’agenda international, le champ de bataille du monde se
déplaçant vers le Sud. Malgré cela,
le mode de gouvernance globale n’a pas évolué
depuis la décolonisation et l’émergence de nouveaux
acteurs.
Entre terrorisme, guerres et nouvelles recompositions
territoriales, comment expliquer la nouvelle marche du monde, qui
suscite interrogations et angoisses ? Une question à laquelle Bertrand
Badie (photo Pauline Le Goff) n’a pas renoncé à répondre. Loin d’être
nostalgique d’une représentation bipolaire issue de la guerre froide,
ce professeur à Sciences-Po, spécialiste des relations
internationales, décrit l’émergence de nouveaux acteurs globaux. Après
un ouvrage sur l’humiliation comme moteur des relations
internationales, il en vérifie aujourd’hui les effets dans son dernier
livre, Nous ne sommes plus seuls au monde. Et esquisse les voies d’un
ordre mondial injuste.
Que signifie ce titre, «Nous ne sommes plus seuls au monde» ?
C’est à la fois une façon de souligner l’apparition des Etats qui ne
comptaient pas auparavant, mais aussi de prendre en considération
l’émergence des sociétés civiles dans l’ordre international. Ce dernier
concept a été inventé à l’échelle continentale par les Européens lors
de la conclusion du traité de paix de Westphalie [au XVIIe siècle,
ndlr]. Les Européens ont fait en sorte que cet ordre normatif européen
soit synonyme d’ordre international. La décolonisation, qui aurait dû
réorganiser ce monde, a été tenue en lisière par la bipolarité du monde
de la guerre froide. Ce n’est ni plus ni moins qu’un enchaînement
de circonstances qui ont fait correspondre l’idée moderne
d’«international» avec l’idée classique de «concert européen». A tel
point que les Etats-Unis ne se sont véritablement internationalisés
qu’en devenant une puissance européenne de plus, notamment en allant
combattre lors des deux guerres mondiales sur le sol européen. Puis ils
se sont inscrits dans un système d’alliances certes atlantique mais
profondément ancré dans le vieux continent.
Les Européens ont dominé le monde grâce à leurs empires coloniaux…
La colonisation a durablement mis en place une division entre un monde
dominant et un monde dominé. Cette logique a pérennisé le périmètre
européen. L’idée d’un système inégalitaire s’est ainsi banalisée et
s’est greffée sur un ordre institutionnel européen composé d’égaux. A
cette évolution géographique s’ajoute l’effet du débordement social que
provoque la mondialisation. Aujourd’hui, l’Occident doit compter avec
un monde qui n’est pas exclusivement le sien, mais aussi avec
l’apparition d’acteurs sociaux devenus globaux. Les sociétés
elles-mêmes font irruption dans l’ordre mondial : celles du Sud, en
particulier, viennent rompre «l’entre soi» occidental, tandis que
la puissance classique ne peut rien sur elles.
En quoi consiste ce que vous appelez «la puissance des faibles» ?
Le champ de bataille du monde a quitté l’Europe et s’est déplacé vers
le Sud, en Afrique sahélienne et centrale, au Moyen-Orient, voire en
Asie centrale. Les nouveaux conflits qui ont fait souche ne sont plus
des conflits de puissance mais de faiblesse. La puissance militaire ne
décide plus de l’issue de belligérances désormais dérivées de la
faiblesse des institutions et des sociétés du Sud. Et surtout, l’agenda
international est commandé par le processus de décomposition qui les
environne et les affecte. Les principaux conflits du monde, au Sahel
par exemple, cumulent une décomposition des institutions politique et
étatique, une quasi-inexistence des nations et des contrats sociaux
ainsi qu’une extrême faiblesse du développement socio-économique. Les
puissants ne décident plus ni des frontières ni des conflits : ils ne
font que réagir ou tenter de contenir. Le début de notre
XXIe siècle a été davantage marqué par des événements enclenchés
par un Ben Laden ou un Al-Baghdadi que par un Bush. Barack Obama
est le premier président américain qui a compris les limites de la
posture réactive de la puissance et qui a donc amendé la routine
interventionniste.
De quand date l’émergence des «faibles» ?
Il y a longtemps. Et rétrospectivement, le plus étonnant est qu’on
n’ait rien vu venir. Il suffit d’observer la chronique du
XXe siècle pour voir apparaître partout dans le monde des
affirmations qui non seulement échappaient à l’attraction occidentale
mais qui, en plus, avaient tendance à se définir contre cet ordre
occidental. Dans les premiers temps, il ne s’agissait pas
d’affirmations violentes. Le premier congrès panafricain se tient
en 1900 et passe inaperçu, mais la Première Guerre mondiale
réveille des identités qui s’affirment comme autres, à l’instar
des conférences panasiatiques. Le premier congrès panislamique se tient
en 1926 au Caire, très peu de temps avant la formation du
mouvement des Frères musulmans. Toutes ces réunions auraient dû
constituer des alertes, mais les Occidentaux n’ont pas prêté attention
à cette volonté de se situer hors de l’Occident.
Comment expliquer l’échec des décolonisations ?
Ce processus a complètement échoué pour deux raisons. La première est
le simplisme de la formule : on pensait pouvoir plaquer notre modèle
sur d’autres. Les Occidentaux estimaient que ces pays se
décoloniseraient pour devenir des Etats à leur image. Paradoxalement,
les principaux importateurs et les promoteurs de la reproduction du
modèle occidental se trouvaient parmi les nationalistes qui avaient
lutté le plus farouchement contre les puissances coloniales. Ils
avaient appris ce modèle chez le colonisateur - Nehru a été formé à
Cambridge -, et les plus turbulents des indépendantistes africains ont
fait leur apprentissage en métropole. Mais comme ce modèle politique
européen s’avère non-reproductible, il perdit sa légitimité, et souvent
s’effondra. L’affaissement de tous ces Etats du Sud est la première
cause des conflits d’aujourd’hui.
La décolonisation est un échec parce qu’elle ne s’est pas faite dans nos imaginaires ?
Mais surtout, le mode de gouvernance du monde n’a pas changé après les
décolonisations. Le pouvoir est resté au sein d’un club oligarchique
extrêmement restreint, que ce soit le Conseil de sécurité ou le G7. Le
G20 n’a jamais réellement vu le jour. Donc ce système a continué à
exclure. Preuve que rien n’a changé et que nous n’avons rien appris,
les Occidentaux réagissent toujours de la même manière aux nouvelles
conflictualités, à coup d’interventions militaires, comme si nous
avions encore affaire à des guerres clausewitziennes. Et même armés des
meilleures intentions, nous ne faisons que nous approprier la guerre
des autres et complexifier ainsi encore plus la situation. Que
ce soit en Afghanistan, en Irak, au Mali, sans parler de la Libye.
Vous affirmez qu’il y a deux mondialisations: celle des forts et celles des faibles. Qu’entendez-vous par là ?
Nous avons commis, et de façon récurrente, une faute capitale, à droite
comme à gauche, celle de confondre mondialisation et accomplissement
d’un modèle néo voire ultralibéral. La mondialisation, à l’origine,
n’est pas un phénomène économique. Elle tient à une transformation du
système de communication. Aujourd’hui, cette communication immédiate
est mortelle pour les relations internationales telles que nous les
connaissions auparavant. Jusqu’à récemment, les frontières et les
territoires permettaient à des souverainetés de s’exercer. Aujourd’hui,
on assiste à une ascension irréversible des mobilisations
transnationales. Une des principales conséquences de
cet approfondissement de la communication est qu’aujourd’hui, le
pauvre voit le fort et le riche: voilà qui renouvelle profondément les
imaginaires et appelle aussi de nouvelles formes de solidarité.
Que peut une puissance moyenne comme la France ?
La France n’a pas encore vraiment intégré qu’elle était une puissance
moyenne et qu’elle n’était plus seule au monde. En tant que puissance
moyenne, elle ne manque pas pour autant d’atouts. Elle a un bon ancrage
multilatéral, que ce soit dans l’ensemble européen ou aux Nations
unies. C’est là qu’elle peut continuer à jouer un rôle. Mais il faut
rompre avec l’idée simpliste, archaïque et réductrice d’une «famille
occidentale» dont elle serait membre. Il faut adopter une politique
étrangère réellement mondialisée, qui s’appuie sur le relais des
différentes organisations régionales et qui comprenne en outre que les
modèles martiaux classiques ne sont plus opérants. Et enfin, il faut
construire une véritable politique de l’altérité : reconnaître l’autre
ne veut pas dire être d’accord avec lui mais admettre la pluralité pour
négocier ensuite les modes de coexistence internationale au lieu de les
décréter.
Cela permettrait-il de mieux conjurer les nouvelles menaces ?
Les nouvelles formes de confrontations qui nous attendent fabriquent
des guerres à étages, des guerres qui ont certes un terrain de conflit,
mais qui ont aussi des capacités à s’étendre par rhizomes partout dans
le monde. Ainsi, la guerre en Mésopotamie [Irak et Syrie] est aussi
présente par les attentats à Paris, à Molenbeek ou en
Seine-Saint-Denis. Or, notre première réaction au lendemain du
13 Novembre a été d’annoncer des bombardements sur la Syrie :
c’est une diplomatie anachronique de champ de bataille. Idem au
Mali, où François Hollande a déclaré vouloir «détruire» les
terroristes. On ne détruit pas des lambeaux de sociétés. Il y a dans le
monde quelque 500 000 enfants soldats. Ce ne sont pas nos
ennemis, ce sont des enfants de sociétés qui se délitent. Face auxquels
le choix martial est absurde. Le traitement qui s’impose n’est plus
militaire, mais social.Réfléchissons donc à un travail
de containment et de police internationale plus que d’action
militaire internationale.
21
Mars 2016
Abonnez-Vous à Libération
Retour à la Résistance Culturelle
Retour au sommaire
|